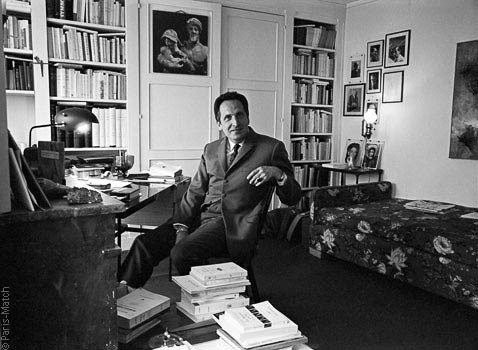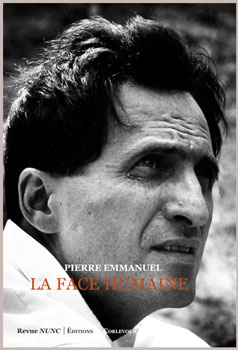Les nouveautés sur le site
|
• Cela s'est passé un... Semaine du 1 au 8 février (ci-dessous).
• L'extrait du mois :
- Chansons du dé à coudre, Fribourg-Paris, Egloff-L.U.F., 1947, p. 189 ; Œuvres complètes, vol. I, L’Âge d’Homme, 2001, p. 1001.
- « Poésie et prière », cf. fichier « Conférences », et parue dans Cahiers de Neuilly, n.s., n° 3 (avril 1963), p. 3-24, repris dans « Dire, c’est aimer », La face humaine, Seuil, 1963, p. 135.
• « The power of the poet », The Atlantic, n° 187, janvier 1951, p. 74-77.
• 28 novembre 2019 : décès de M. François Livi, exécuteur testamentaire du poète et président du Centre de recherche. Cf. colonne de droite (Centre de recherche).
----------------
Mme Catherine Emmanuel Carlier, présidente de l'Association des Amis de Pierre Emmanuel, lui rend ici hommage.Chers Amis,
La nouvelle de la mort de François Livi nous a tous bouleversés, il est parti trop vite, trop tôt.
Au fil du temps nous avions appris à le connaître. Nous aimions son humour, la qualité de son écoute, son humilité, sa bienveillance.
Parfois, il se plaisait à nous raconter sa première rencontre avec Pierre Emmanuel, en 1966 rue de Varenne, alors qu’il était un tout jeune étudiant et comment très vite ils se lièrent d’une profonde amitié. Une amitié qui ne s’est jamais démentie.
François Livi exécuteur testamentaire de Pierre Emmanuel fut le président du Centre de recherche, crée en 1986. Il a beaucoup œuvré, avec tous les membres du Centre, à la connaissance et à la mémoire du poète et nous lui en sommes très reconnaissants.
Comme il va nous manquer lui qui nous a tant donné et tant appris !
Catherine Emmanuel Carlier
Présidente de l’Association des amis de Pierre Emmanuel
----------------
• Des nouvelles dans "On en parle...", colonne de droite: livres, émissions et articles nouveaux sur Pierre Emmanuel
• IMPORTANT : Les photos, textes et autres documents de ce site ne sont pas libres de droit, ceux de Facebook ou des affiches non plus.
• Rappel : les liens sont visibles lorsqu'on passe sur le texte.
Le mot de l'Association
Depuis sa création, en 1985, l'Association s'est attachée à servir la mémoire de Pierre Emmanuel et à faire connaître son œuvre en apportant son soutien à des publications, rencontres, expositions, émissions radiophoniques et à différents hommages en France comme à l'étranger.
La création d'un site Pierre Emmanuel s'est imposée comme une évidence et une priorité. Un nouvel outil pour retracer l'itinéraire de l'écrivain, du poète et de l'homme d'action engagé dans son siècle en faisant découvrir ses multiples visages : l'homme de culture, son action auprès des médias, mais aussi l'homme de foi, l'homme courageux, le résistant, le défenseur des droits de l'homme.
C'est un travail énorme qui fut engagé, un travail exigeant et rigoureux mené par Anne Simonnet (*) aidée dans ses recherches par des témoins de la vie de Pierre Emmanuel, par le Centre de recherche et par la famille du poète. Une approche aussi complète a nécessité des années de consultation dans les archives de la BNF, de l'Imec, l'Ina, et d'autres fonds. Des manuscrits, des photographies, des lettres et des documents souvent inédits, prêtés par des amis, des proches ou d'anciens collaborateurs de Pierre Emmanuel ont considérablement enrichi le site.
Pierre Emmanuel visionnaire, initiateur et créateur de la Vidéothèque (Forum des Images), confiant dans les nouvelles technologies, aurait certainement apprécié l'instrument de connaissance, de dialogue et d'échange que constitue un tel site.
Proposer un site clair, lisible, complet et accessible à tous, telle fut notre démarche pour que Pierre Emmanuel reste vivant dans les mémoires.
Catherine Carlier, Présidente de l'Association
(*) Anne Simonnet est professeur de Lettres classiques, Docteur ès Lettres, auteur de l'ouvrage Pierre Emmanuel, poète du Samedi saint et d'une thèse : Le Christ de Pierre Emmanuel. L'élaboration d’un mythe personnel.
Cela s'est passé un... (La micro-information du jour)
1 février
1 février 1962
« En chemin », article de Pierre Emmanuel dans Réforme, n° 985, p. 13. « La reconnaissance de la Chine populaire est dans la logique des faits. Que ce grand fait soit de bonne politique, mon rôle ici n’est pas d’en discuter. Quelles que soient les arrières-pensées de celui qui a pris cette décision capitale, il se peut que l’une d’elles soit qu’un tel acte rend à la France, aux yeux du Tiers-Monde, une primauté morale que, la décolonisation réussie, notre pays entend assumer en la personne de son chef. (…) C’est faire en tout cas belle confiance au destin que d’équilibrer par un humanisme politique à la française la formidable ambition totalitaire dont la Chine ne nous laisse ignorer ni la nature ni l’impatience. Ce que cette attitude comporte de foi dans l’esprit de l’homme, et aussi dans l’âme des peuples, donne au risque par ailleurs calculé une dimension inhabituelle en politique. Comme il arrive souvent chez le général de Gaulle, l’identification à la France idéale rejoint une idée universelle de l’homme et passe très haut par-dessus la tête de la plupart des Français “réels”.
2 février
2 février 1952
Diffusion d’une émission radiophonique sur Babel dans la série « Des idées et des hommes » de Jean Amrouche. « [L]a grande force, la leçon morale des camps de déportation, c’est en fin de compte la possibilité de préserver, la possibilité pour certains de préserver une réalité spirituelle intangible. Dans le poème dont il s’agit [« L’hymne des témoins »] je me réfère à l’expérience même de Martin-Chauffier qui, battu avec ces tuyaux de plomb, je crois, dont les soldats nazis se servaient pour flageller leurs victimes, se récitait des poèmes de Virgile pour ne pas flancher et ne pas crier. Il y a dans cette volonté de garder malgré tout et dans l’humiliation totale ce qui est essentiel, il y a évidemment un témoignage absolu quant à l’homme. Et c’est le sens de ce poème-là. Alors de ce poème est né, pourrait-on dire, l’ensemble du livre. »
3 février
3 février 1978
Alain Bosquet, « La nouvelle symphonie de Pierre Emmanuel », Le Monde des livres, p. 1. « Au sens beethovénien du terme, Pierre Emmanuel, à côté d’œuvres poétiques moins vastes, publie des symphonies qui forment, dans les profondeurs de son psychisme, les étapes capitales de son évolution. Ainsi, on peut dire que Babel, après les poèmes de Résistance, marquait le souci de construire un monde moral et chrétien, dans les années 50. Ainsi, en 1970, Jacob était une réflexion sur la finalité de l’homme, à la fois détaché du siècle et plongé en pleine ère atomique. Ainsi, en 1973, Sophia traduisait, avec toutes les ambiguïtés souhaitables, le balancement entre le tourment intérieur et la sagesse fugacement entrevue. / Tu, somme de souffrances, de discours pour l’honneur de l’homme et de tentatives pour saisir l’impondérable, relève de la même ambition : c’est assurément le livre de poèmes le plus ample, le plus épique et le plus passionné de ces dernières années, avec ses alluvions immenses, son accumulation de pensées et de mots d’ordre, et quelquefois ses facilités ostensibles. »
4 février
4 février 1980
« La gauche et les droits de l’homme », article de Pierre Emmanuel dans Le Figaro, p. 1, 6. « Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des intellectuels. Depuis deux siècles et demi, il a largement façonné la vie politique et sociale. Les grandes idéologies qui nous dominent sont des théories portant sur l’homme avant d’être des méthodes de gouvernement ou des pratiques de la révolution.
Il y a quelque chose d’enivrant dans ces doctrines : ce sont des explications totales de l’histoire, des utopies réalisées. Ceux qui les admettent ne se posent pas la question de leur adéquation au réel, mais, comme le dit Alain Besançon, travaillent à imposer de force la surréalité contre le réel lui-même.
Pour atteindre à la société idéale, où l’homme enfin désaliéné sera définitivement libre et bon, la pire contrainte est éventuellement justifiable, et la terreur. »
5 février
5 février 1955
Diffusion de la cinquième émission radiophonique de la série « La vocation poétique, entretien avec Pierre Emmanuel » dans la collection « Des idées et des hommes » de Jean Amrouche. « [L]’enfer, c’est le chaos des instincts. Des instincts qui ne sont pas encore arrivés à la lumière, parce qu’ils n’ont pas trouvé peut-être, la forme à travers laquelle s’exprimer et en même temps s’exorciser. Dans Le Poëte et son Christ, il y a déjà, en tout cas jusqu’à un certain point, victoire sur le sentiment de l’irrémédiable mort. Mais ce n’est pas suffisant en ce sens que le Christ, dans Le Poëte et son Christ, reste toujours la figure médiatrice essentielle et même dans ce poème intitulé “Lazare ressuscitant”, où c’est bien Lazare, c’est-à-dire un homme, qui ressuscite, c’est tout de même le Christ qui va le chercher au fond du tombeau pour l’en faire surgir et qui fait l’épreuve du chaos intime, du désordre, et de l’espèce de division qui règne au cœur de Lazare. Il fallait donc qu’une occasion me fût fournie, à moi, de me mesurer avec ce monde intérieur que jusqu’alors je n’avais exprimé que par des symboles. Des symboles qui m’étaient en partie extérieur, puisqu’ils étaient empruntés à de grandes images traditionnelles. »
6 février
6 février 1984
Écriture de « Comment financer nos retraites ? », article de Pierre Emmanuel pour France catholique. « Martine Alain-Régnault, parlant à la télévision de la nouvelle propagande nataliste, en donne une raison que je note sur le champ. “La France, dit-elle, manque d’enfants qui demain pourraient nous aider à payer nos retraites.” C’est sans doute vrai, mais que cette raison soit pour elle la seule à mettre en avant peut sembler court. Qu’est-ce qui la dicte ? Certainement pas la perspective de sa propre retraite : cette femme dans la force de l’âge a ses années d’activité professionnelle devant soi. Lier le désir de l’enfant à un intérêt personnel des parents, lui est-ce une façon de dénoncer le zèle démographique des Debré ou des Chaunu par exemple ? Est-ce, plus secrètement, exprimer son hostilité à l’idée de génération, de perpétuation de la vie ? Ou encore, inconsciemment cette fois, dire sur soi-même quelque chose qui ne peut être proféré qu’en l’objectivant, en lui donnant l’air d’une généralité ?
Il se peut qu’un tel argument entre dans un ensemble économique précis, mais je ne sache pas que dans la conception de l’enfant il ait une importance quelconque. Cette conception, quand elle est voulue, est une œuvre d’amour où seul le présent compte, le présent éternel d’un nouvel être à venir, d’un être qui est déjà. Et même quand elle survient par hasard, elle peut se changer en œuvre d’amour : le cas est plus fréquent qu’on ne pense. »
7 février
7 février 1975
Jean-Pierre Leonardini, « Jacob au pied de l’échelle », L’Humanité, p. 10. [À propos de la création de l’INA] « L’institut aura pour mission, entre autres, “d’étudier et d’orienter l’évolution concrète des media : radio, télévision. vidéo-cassettes, vidéo-disques, télévision par câbles (circuits fermés de télévision à la dimension de l’école, de l’université, de l’entreprise, de l’immeuble ou de la ville)”... Suit un exposé des travaux multiples qui incombent à l’institut. “Devant cette tâche énorme, nos moyens sont faibles.” / Sauf le respect dû au poète, on ne peut s’empêcher de songer qu’il est pris en otage consentant. Aura-t-il les moyens qu’il réclame ? On en doute. »
8 février
8 février 1977
Enregistrement d’une émission radiophonique dans le cadre de la collection « De la nuit » de France culture. « [L]’amour… c’est le passage à autrui, l’abandon de l’égoïsme, de l’égocentrisme ; ça ne se fait pas nécessairement par une cassure brutale. Il y a un apprentissage, chez la plupart des gens, de l’amour. Quelquefois cet apprentissage risque d’ailleurs de les illusionner sur la véritable nature de l’amour ; parce qu’ils passent des moments de la révélation initiale à l’habitude… Or maintenir l’amour à l’état de révélation, ce n’est pas donné à tout le monde, et peut-être cela suppose-t-il de la part des deux amants un projet qui les transfigure. Est-ce qu’on peut demander à tout un chacun cela ? Est-ce que tout un chacun se demande cela ? »